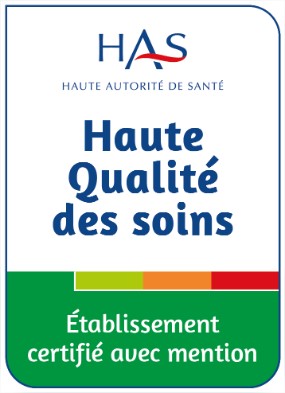- Nous connaître
- Nos spécialités
- Prendre rendez-vous
- Votre séjour
Présentation
Anesthésie
Sous la responsabilité d’un seul chef de service, le Dr Jean-Michel Devys, l’Institut d’Anesthésie de l’Est Parisien assure la qualité et la sécurité des anesthésies des patients de deux établissements de santé, notre groupe hospitalier et l'Hôpital Fondation Rothschild, en couvrant l’ensemble du spectre de cette discipline hors cardiologie.
L’équipe du groupe hospitalier Diaconesses Croix Simon est spécialisée dans l’anesthésie loco-régionale, particulièrement utile en chirurgie orthopédique, dans la prise en charge des chirurgies complexes et douloureuses ainsi que dans la prise en charge de la chirurgie de la femme et de l’accouchement.
L’équipe d’anesthésie participe à l’enseignement des jeunes médecins. Nous accueillons chaque année 6 internes. Vous êtes susceptibles de les croiser en consultation, ainsi qu’au bloc opératoire.
La recherche nous permet de mettre à jour et d’améliorer sans cesse nos pratiques. Tout patient peut se voir proposer de participer à un protocole de recherche sur l’anesthésie ou la prise en charge de la douleur. Pour en savoir plus sur la recherche au sein de notre établissement, cliquez ici.
Prise en charge
Avant l'intervention
La consultation d’anesthésie
Un rendez-vous de consultation d’anesthésie vous sera donné au terme de votre consultation de chirurgie. Celle-ci est obligatoire et doit avoir lieu au mieux 3 semaines avant votre intervention (6 semaines pour la chirurgie de prothèse orthopédique).
Cette consultation vise à :
- Évaluer votre état de santé général et discuter de la technique d’anesthésie la plus appropriée pour votre intervention,
- Vous fournir toutes les informations nécessaires concernant la prise en charge de la douleur après l’intervention,
- Vous exposer les risques liés à l’anesthésie.
Il vous sera donc demandé d’apporter des documents lors de cette consultation : derniers examens sanguins, derniers examens cardiologiques, ordonnance de traitements (notamment les anticoagulants), le questionnaire d’anesthésie complété.
La consultation d’anesthésie est ouverte du lundi au vendredi de 8H45 à 12H30 et de 13H45 à 17H00. Les rendez-vous se prennent par téléphone au : 01 44 64 16 00
Si vous avez une impossibilité ou une difficulté, pensez à prendre contact avec l’accueil de la consultation d’anesthésie au 01 44 64 43 52
Votre consentement est essentiel
Lors de cette consultation, nous vous demanderons de signifier par écrit votre accord pour cette prise en charge. En cas de geste chirurgical à risque hémorragique, le médecin vous donnera une information spécifique sur la transfusion sanguine. Là encore, il vous sera demandé de signifier par écrit votre accord à une éventuelle transfusion.
Attention : Pour une chirurgie à risque hémorragique, le refus de « consentement à l’acte transfusionnel », quelle qu’en soit la raison religieuse ou philosophique, entraînerait une annulation de l’acte opératoire.
Il est possible que l’anesthésiste que vous verrez en consultation ne soit pas celui qui vous prendra en charge au bloc opératoire. De même, des infirmiers anesthésistes collaborent avec les médecins anesthésistes tout au long de votre prise en charge au bloc opératoire. Cependant, quel que soit le professionnel qui s’occupe de vous, il aura pris connaissance de votre dossier, et des décisions qui ont été prises lors de la consultation d’anesthésie.
Pendant l’intervention
À votre entrée au bloc opératoire, l’anesthésiste administrera l’anesthésie adaptée au type d’opération qui aura été vue avec vous en consultation.
Après la chirurgie, tout patient est pris en charge en salle de surveillance post-interventionnelle pendant le temps nécessaire pour retrouver une autonomie des grandes fonctions vitales et que la douleur soit correctement soulagée. En fonction de l'intervention, vous serez ensuite orienté soit en secteur ambulatoire, soit en secteur d’hospitalisation, soit en réanimation-unité de soins continus.
Hospitalisation en ambulatoire
Cette prise en charge courte, qui dure moins d’une journée, est souvent plus confortable pour le patient, et réduit le risque d’infection contractée à l’hôpital. Elle vous sera proposée si elle est compatible avec votre intervention.
Cette prise en charge nécessite quelques précautions :
- Le respect des règles de jeûne avant l’opération - pas d’alimentation après minuit, eau / thé / café sucrés sont encouragés jusqu’à 2 heures avant l’arrivée à l’hôpital
- Prévoir un accompagnant pour le retour à domicile et de ne pas être seul pendant la 1ère nuit après l’opération.
Les différents types d'anesthésie
En fonction de votre état de santé et de l’intervention programmée, plusieurs types d’anesthésie peuvent vous être proposés. Ces options vous seront détaillées durant la consultation d’anesthésie, afin de prendre la décision la plus appropriée.
L’anesthésie locorégionale ou anesthésie locale
Qu'est-ce que l'année locorégionale ou locale ?
Cette technique permet d’endormir uniquement la partie du corps opérée. Elle permet d’éviter l’anesthésie générale, et d’anticiper les douleurs post-opératoires, et ce afin de favoriser un retour rapide à domicile.
Il existe plusieurs techniques pour endormi localement et sera déterminée en fonction du type d’intervention :
- L'anesthésie locale permet de supprimer la sensibilité à la douleur au niveau de la région à opérer : elle est injectée par le chirurgien.
- L'anesthésie locorégionale est réalisée au niveau des structures nerveuses qui innervent la région à opérer pour insensibiliser pendant l'intervention ou pour calmer la douleur en post-opératoire.
- La rachianesthésie : la technique consiste à injecter dans l’espace rachidien lombaire une solution d’anesthésique local. Cette injection provoque une anesthésie puissante du siège voire des membres inférieurs. Cette technique est largement employée pour la chirurgie proctologique, urologique, gynécologique voire orthopédique.
Quelques précautions à respecter :
- Les règles du jeûne sont identiques à celles de l’anesthésie générale : pas d’alimentation après minuit, eau / thé / café sucrés sont encouragés jusqu’à 2 heures avant l’arrivée à l’hôpital.
- Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter des écouteurs avec dispositifs musicaux (téléphone hors ondes GSM, MP3) que vous pourrez utiliser pendant la chirurgie.
L'anesthésie générale
Qu'est-ce que l'anesthésie générale ?
Elle provoque chez le patient un état comparable au sommeil. Après administration d'un calmant (prémédication) et mise en place des perfusions, l'anesthésie débute en règle générale par l'injection d'un somnifère d'action rapide, puis se poursuit par l'injection ou l'inhalation de certains médicaments anesthésiques. Cet état est maintenu par l'anesthésiste à l'aide de médicaments, pendant toute la durée de l'opération.
Pour certaines interventions simples, une respiration spontanée est conservée mais le plus souvent, les médicaments anesthésiques suppriment la respiration ce qui nécessite d'avoir recours à des moyens spécifiques :
- Soit un masque laryngé posé devant le larynx,
- Soit une sonde d'intubation introduite dans la trachée qui relie vos poumons à une machine « qui respire à votre place ».
Pendant toute la durée de l'anesthésie, le médecin anesthésiste ou l'infirmière anesthésiste sous sa responsabilité surveille en permanence toutes les fonctions organiques (pouls, tension artérielle, respiration, ECG, oxygénation etc...). Une fois l'intervention terminée, l'administration de l'anesthésie est interrompue et vous vous réveillez.
L'anesthésie à la maternité
Une consultation est réalisée par un médecin anesthésiste-réanimateur dans les quelques semaines précédant votre accouchement. N’hésitez pas à cette occasion à poser toutes les questions que vous jugerez utiles.
Qu'est-ce que l'anesthésie péridurale ?
C’est une technique d’anesthésie locorégionale réalisée par un médecin anesthésiste-réanimateur. Elle est destinée à supprimer ou à atténuer les douleurs de l’accouchement et/ou, si besoin, à en faciliter le déroulement. C’est à ce jour la méthode la plus efficace.
Son principe est de bloquer la transmission des sensations douloureuses au niveau des nerfs provenant de l’utérus en injectant à leur proximité un produit anesthésique local associé ou non à un dérivé de la morphine. Cette technique assure une bonne stabilité des fonctions vitales, bénéfique pour la mère et l’enfant.
Ce blocage se fait à proximité de la moelle épinière dans l’espace péridural, par l’intermédiaire d’un tuyau très fin (cathéter) introduit dans le dos à l’aide d’une aiguille spéciale. Le cathéter reste en place pendant toute la durée de l’accouchement afin de permettre l’administration répétée de l’anesthésique. S’il est nécessaire de pratiquer une césarienne ou toute autre intervention, l’anesthésie pourra être complétée par ce dispositif ; ce qui n’exclut pas le recours à l’anesthésie générale au décours de l’accouchement.
Au moment de bénéficier de l’analgésie péridurale, vous aurez la visite du médecin anesthésiste- réanimateur qui vous prendra en charge et les données de la consultation seront actualisées. Il peut arriver, en fonction de votre état de santé ou du résultat des examens complémentaires qui vous auront éventuellement été prescrits, que l’analgésie péridurale ne puisse être effectuée, contrairement à ce qui avait été prévu.
C’est le cas, par exemple, s’il existe de la fièvre, des troubles de la coagulation du sang, une infection de la peau au niveau du dos ou toute autre circonstance pouvant être considérée à risque. Le choix définitif et la réalisation de l’acte relèvent de la décision du médecin anesthésiste-réanimateur et de sa disponibilité.
Comment serez-vous surveillée pendant l’analgésie péridurale ?
Comme tout acte d’anesthésie, l’analgésie péridurale se déroule dans une salle équipée d’un matériel adéquat, adapté à votre cas et vérifié avant chaque utilisation.
Durant l’analgésie péridurale, vous serez prise en charge par une équipe comportant le médecin anesthésiste-réanimateur, la sage-femme, et éventuellement une infirmière anesthésiste diplômée d’état.
Quels sont les inconvénients et les risques de l’analgésie obstétricale ?
Tout acte médical, même conduit avec compétence et dans le respect des données acquises de la science, comporte un risque. Les conditions actuelles de surveillance de l’anesthésie permettent de dépister rapidement les anomalies et de les traiter.
Pendant l’analgésie péridurale, une sensation de jambes lourdes et une difficulté à les bouger peuvent s’observer. C’est un effet sans gravité de l’anesthésique local. Au moment de la sortie du bébé, l’envie de pousser est souvent diminuée et une sensation de distension peut être perçue.
Une difficulté transitoire pour uriner est fréquente lors d’un accouchement et peut nécessiter un sondage évacuateur de la vessie. Une baisse transitoire de la pression artérielle peut survenir.
Si les dérivés de la morphine ont été utilisés, une sensation de vertige, des démangeaisons passagères, des nausées sont possibles. Des douleurs au niveau du point de ponction dans le dos peuvent persister quelques jours mais sont sans gravité.
L’analgésie peut être insuffisante ou incomplète pendant les contractions. Une nouvelle ponction peut alors être nécessaire, de même qu’en cas de difficulté de mise en place ou de déplacement du cathéter.
Exceptionnellement, des maux de tête majorés par la position debout peuvent apparaître après l’accouchement. Le cas échéant, leur traitement vous sera expliqué. Dans de très rares cas, une diminution transitoire de la vision ou de l’audition peut être observée.
Des complications plus graves : convulsions, arrêt cardiaque, paralysie permanente ou perte plus ou moins étendue des sensations, sont extrêmement rares. Quelques cas sont décrits, alors que des centaines de milliers d’anesthésies de ce type sont réalisées chaque année.
Enfin, pour votre bébé, l’accouchement sous analgésie péridurale ne comporte pas plus de risque qu’un accouchement sans péridurale.
Notre équipe
Chef de service adjoint
Cadre supérieure de santé
- Mme N.KOUZMINA
Médecins titulaires au Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon
- Dr O. Akinbusoye
- Dr B. Baha
- Dr T. Bartelmaos
- Dr W. Braham
- Dr C. Dilasser
- Dr M. Dorison
- Dr A. Doval
- Dr A. El Metni
- Dr A. Gutrach
- Dr K. Hodjat-Panah
- Dr M. Ikhouane
- Dr O. Imauven
- Dr S. Kacimi
- Dr O. Koussawo
- Dr M. Pernice
- Dr C. Rebière
- Dr N. Rezig
- Dr EM. Schmautz
- Dr A. Solis
- Dr D. Taing
- Dr N. Ung
- Dr J. Vrecq
Médecins assistants :
- Dr P. Devidas
- Dr F. Hontarrede
Secrétariat de l'anesthésie
- Mme L. Maurer
Contact
Vous pouvez contactez le secrétariat au : 01 44 64 28 88 ou par email à anesthesie-etage@hopital-dcss.org
Attention : Ne transmettez pas vos données de santé personnelles par email. Si vous avez une question précise sur votre dossier médical, merci de contacter le service par téléphone.