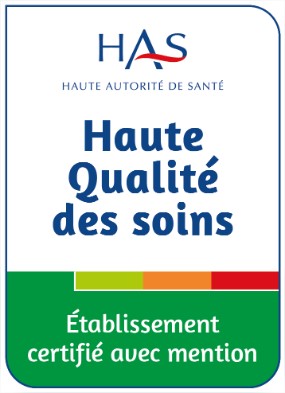Cette notice est destinée à vous fournir les informations principales sur la chirurgie du rectum, les différentes interventions et leurs indications, leurs risques et conséquences habituels. Elle ne saurait être exhaustive et votre cas personnel peut être sensiblement différent des descriptions que vous y trouverez.
Des informations plus spécifiques, plus personnelles, plus précises et adaptées vous seront fournies par votre gastro- entérologue et votre chirurgien qui vous engagent à les interroger.
Anatomie
Le rectum est la dernière portion du tube digestif, faisant suite au sigmoïde. Il comprend le canal anal, haut de 3 à 4 cm, siège d’une muqueuse différente du reste du colon et du rectum, et d’une pathologie spécifique (hémorroïdes, abcès, fistules, ...).
Le rectum qui nous intéresse ici a une hauteur d’environ 12 à 15 cm ; sa partie initiale est étroite (charnière recto-sigmoïdienne), la portion sous jacente étant large, en forme d’ampoule. Par convention ce rectum est divisé en 3 tiers : supérieur (la partie étroite), moyen et inférieur.
Le rectum est constitué d’une paroi digestive, muqueuse et musculeuse, entourée d’un fourreau graisseux contenant ses vaisseaux sanguins et lymphatiques, ses ganglions, ses nerfs. Ce fourreau, épais en arrière et latéralement, est appelé méso rectum.
Autour du rectum, sur la paroi pelvienne, cheminent les vaisseaux et nerfs destinés aux organes voisins, en particulier la vessie et les organes génitaux. Ainsi les nerfs responsables, chez l’homme, de l’érection, de l’éjaculation contournent le rectum, et en sont à certains endroits (au tiers inférieur) très proches.
Fonction
Réservoir accueillant les selles avant la défécation, le rectum, par son canal anal et les muscles qui l’encerclent et le soutiennent (sphincter interne, sphincter externe, releveurs de l’anus) nous assure une continence : des capteurs sensoriels nous informent sur le besoin d’évacuer des gaz ou des matières fécales, et c’est par un acte volontaire, conscient, que nous décidons d’exonérer. Régie par des mécanismes délicats, complexes et pas totalement élucidés, la fonction n’est parfaite que lorsque ses composants sont intacts : tissus sains, souples, muscles et nerfs intacts.
Indications de la chirurgie
La chirurgie du prolapsus rectal, et plus généralement, des troubles de la statique rectale n’est pas envisagée dans cette note, faisant l’objet d’une information spécifique. De même les lésions du canal anal et leurs traitements (hémorroïdes, suppurations..) sont décrits ailleurs. Ainsi les indications de cette chirurgie sont-elles essentiellement des tumeurs, bénignes ou malignes.
Exérèses transanales
Elles consistent à enlever les lésions par voie transanale (« par les voies naturelles »), en dilatant l’anus, et en y installant un dispositif permettant d’accéder à la paroi rectale.
Une telle exérèse peut être étendue, en circonférence comme en hauteur (dans les mains d’un chirurgien formé à ces techniques), mais elle ne peut enlever tout le tissu qui entoure la paroi rectale, le méso rectum. C’est pourquoi ce type de chirurgie ne s’adresse qu’à des tumeurs bénignes (par définition limités à la paroi rectale elle-même) ou, à la rigueur, à des tumeurs malignes de petite taille, peu pénétrantes dans la paroi rectale, sans aucun signe d’extension péri rectale.
De réalisation assez rapide, peu douloureuses, pratiquement non hémorragiques, ces opérations ne nécessitent qu’un séjour hospitalier bref, de quelques jours. La dilatation anale importante qu’elles imposent laisse une incontinence très nette pendant 2 à 6 semaines. Cette incontinence disparaît progressivement, pratiquement toujours sans séquelle. Le risque infectieux local fait toujours prescrire des antibiotiques pour quelques jour
Exérèses rectales
Elles sont conduites par voie abdominale : la dissection s’effectue dans le ventre et non par ou autour de l’anus. Leur étendue dépend surtout de la localisation de la tumeur à traiter, mais aussi de sa taille. Le point crucial de la décision chirurgicale, qui conditionne entièrement l’avenir fonctionnel, est de déterminer si le circuit naturel des selles peut ou non être conservé. Autrement dit si l’anus, et sa fonction de continence, sera préservé ou s’il doit être supprimé, conduisant à créer un « anus artificiel », encore appelé colostomie (abouchement du colon sur la peau de l’abdomen, couramment appelé « poche » par les opérés, par assimilation à son appareillage).
Depuis 30 ans de gros progrès techniques ont été réalisés pour permettre cette chirurgie conservatrice, sans augmenter le risque de récidive tumorale et en assurant une fonction normale ou proche de la normale. Schématiquement lorsque le pole inférieur de la tumeur n’atteint pas le canal anal, lorsque l’appareil sphinctérien est intact, on peut préserver le canal anal et les muscles qui l’entourent et assurer une continuité digestive en abaissant le colon sur l’anus.
En revanche si le canal anal est atteint, sa suppression devient indispensable à la guérison. C’est ce qu’on appelle une amputation abdomino-périnéale du rectum, nécessitant une colostomie définitive (la région qui portait l’anus est refermée, cousue).
Dans tous les autres cas, donc, une préservation de la fonction anale est possible : après avoir enlevé une portion plus ou moins étendue du rectum, le colon sus-jacent est abaissé sur le moignon rectal conservé, pour y être recousu.
Une meilleure connaissance (assez récente) du mode de diffusion des tumeurs rectales a permis d’établir comme principe que le traitement des cancers du rectum nécessitait l’exérèse (=le retrait) non seulement de la tumeur mais aussi du méso rectum, y compris à distance de la tumeur (total mesorectal excision ou TME des anglo-saxons). Ainsi il est fréquent que la quasi-totalité du rectum soit enlevée, ne laissant que le canal anal et 1 à 3 cm de paroi rectale sus jacents. Le raccordement avec le colon (appelé anastomose) est effectué par un procédé d’agrafage mécanique à l’aide d’un dispositif spécial appliquant des micro agrafes de titane.
Lorsque tout le rectum doit être enlevé jusqu'au canal anal lui-même, les gestes de dissection du bas rectum sont réalisés par voie transanale (techniquement appelée dissection inter sphinctérienne). La suture est alors réalisée manuellement entre le colon et l’anus (anastomose colo-anale).
Les temps de dissection abdominale peuvent être réalisés par laparotomie (ouverture conventionnelle, dite chirurgie «open») ou par laparoscopie (=coelioscopie).
Il est maintenant établi qu’entre des mains habituées à ces gestes laparoscopiques, la chirurgie y est aussi sûre. De sorte que ces techniques se développent en espérant réduire, pour le patient, la lourdeur de l’intervention, son inconfort, ses complications générales.
Risques et conséquences
Vous avez compris que ces exérèses rectales sont des interventions lourdes, souvent longues (3 à 6 heures). Elles comportent les risques généraux de ce type de chirurgie (pulmonaires, cardiaques, phlébites etc....)
Plus spécifiques et assez fréquents sont les risques liés à l’anastomose, très souvent basse, sur l’anus ou à peine au- dessus. Les défauts de cicatrisation, source d’infection locale aux conséquences potentielles graves, appelés fistules ont une fréquence, dans les travaux récents, d’environ 15%. C’est la raison pour laquelle habituellement ces sutures sont « protégées » par une dérivation temporaire (abouchement de la fin de l’intestin grêle ou du colon). Quelques semaines après l’opération cette stomie est refermée, ce qui n’est qu’une intervention locale, limitée, sans réouverture de l’abdomen.
A distance, après fermeture de cette stomie, la fréquence des selles est modifiée ; elles sont souvent plus nombreuses, fractionnées. Pour réduire ce fractionnement et le nombre quotidien d’émissions, nous réalisons souvent des élargissements du colon abaissé sur le bas rectum (divers procédés plastiques sont en usage, chacun ayant des avantages et des inconvénients).
La continence n’est jamais parfaite, aux gaz et aux selles liquides, dans les premiers mois, surtout si une radiothérapie a été associée à la chirurgie. Mais elle s’améliore avec le temps et permet dans plus de 90% des cas de mener une vie normale.
Après amputation du rectum, une vie normale est également possible : la présence d’une colostomie définitive représente un traumatisme psychologique surmontable, et n’empêche nullement une vie familiale, professionnelle et sociale normale. Des associations de stomisés sont là pour vous aider à surmonter les difficultés que vous rencontrez les premiers temps, pour vous conseiller sur les différentes techniques d’appareillage. Ces techniques ont énormément progressé et autorisent, vraiment, une vie normale (techniques d’irrigation...).
Vie sexuelle
La dissection du méso rectum a enseigné aux chirurgiens à reconnaître, disséquer et préserver l’innervation sexuelle. Ainsi le taux de séquelles sexuelles, défaut d’éjaculation, défaut d’érection, a considérablement diminué. Evidemment les capacités sexuelles post opératoires sont aussi liées à l’âge du patient et à ses possibilités préalables à la chirurgie. Globalement la fonction sexuelle est préservée chez 80% des opérés.
Toutefois il arrive que le volume tumoral, débordant le méso rectum, impose un sacrifice nerveux délibéré.
Reprenant les premières lignes de cette note nous attirons de nouveau votre attention sur le fait que chaque cas est particulier, justifie un traitement adapté, des informations personnelles, et que cette pathologie nécessite des traitements souvent combinés et complexes, fruit d’un travail d’équipe, de médecins, d’oncologues, chirurgiens spécialisés.
Bon à savoir
Fumer augmente le risque de complications chirurgicales de toute chirurgie.
Arrêter de fumer 6-8 semaines avant l'intervention élimine ce risque supplémentaire.
Si vous fumez, parlez-en à votre médecin, votre chirurgien et votre anesthésiste ou appelez la ligne Tabac-Info-Service au 3989 pour vous aider à réduire les risques et mettre toutes les chances de votre côté.